
Jean Racine naît le 22 décembre 1639, à La Ferté-Milon. Il est issu d’une famille de « contrôleurs du petit grenier à sel » de La Ferté-Millon sur plusieurs générations.
Sa mère meurt alors qu’il était âgé d’un an, et son père deux ans plus tard. Jean Racine est alors élevé, avec sa sœur, par son grand-père.
On l’envoie à Beauvais apprendre le latin. Il sort du collège en 1655 et on l’envoie à Port-Royal, où il reste trois ans avant de partir à Paris pour faire sa philosophie.
En 1661, Racine se rend à Uzès auprès d’un de ses oncles jouissant d’un bénéfice ecclésiastique. Il se destine alors à la prêtrise pour recevoir ce bénéfice de la part de son oncle, mais ne va pas jusqu’au bout de la démarche et revient à Paris en 1663.
En 1664, il fréquente Molière. La première pièce de Racine, la Thébaïde, est jouée par la troupe de Molière après l’interdiction du Tartuffe par Loulou XIV. Le sujet de la Thébaïde est tiré de l’Antigone de Sophocle.
En 1665, le peu connu (de nos jours) Alexandre le Grand lui vaut les faveurs du roi Louis XIV et de Mme de Montespan. Dès lors ses tragédies seront très bien reçues à la cour. Alexandre a inspiré un opéra à Lefroid de Méreaux en 1783. Cet Alexandre le Grand sera la cause de la brouille entre Molière et Racine, pour une question de partage des droits d’auteur.
Dès lors et pendant quelques années, Racine enchaînera les tragédies, qui sont toutes entrées dans le répertoire classique. Andromaque (1667) a inspiré à Grétry un opéra du même nom en 1780, ainsi qu’à Rossini son Ermione en 1819. Saint-Saëns a écrit une musique de scène pour Andromaque en 1903.
En 1668, Racine écrit sa seule comédie, les Plaideurs. En 1669, c’est Britannicus, pièce pour laquelle André Jolivet a écrit une musique de scène en 1946.
En 1670, c’est Bérénice. La Clémence de Titus de Mozart, dont le livret est une adaptation de celui écrit par Métastase, est indirectement inspiré de Bérénice (1670).
En 1672, Racine écrit Bajazet, et en 1673 Mithridate, dont Mozart encore s’est inspiré pour son Mithridate, Roi du Pont.
Fin 1672, Racine est nommé à l’Académie française.
En 1674, il écrit Iphigénie dont Gluck s’inspirera pour son Iphigénie en Aulide.
Encore un chef-d’œuvre en 1677 avec Phèdre, pièce pour laquelle Racine s’est inspiré d’Euripide avec son Hippolyte. Phèdre a inspiré Rameau pour son opéra Hippolyte et Aricie (1733). En 1786, c’est Jean-Baptiste Moyne qui écrit la tragédie lyrique Phèdre et deux siècles plus tard, Britten écrira la cantate Phaedra.
En 1677, Racine abandonne l’écriture de ses pièces pour devenir historiographe de Loulou XIV. Il se réconcilie avec ces Messieurs de Port-Royal, et abandonne sa maîtresse pour épouser Catherine de Romanet, issue comme lui de la bourgeoisie. Ils auront sept enfants. Parmi ses charges d’historiographe, il y avait l’écriture des hauts faits du roi sous les médailles représentant ses hauts faits. Ainsi en 1683, il entre avec son ami Boileau à l’Académie royale des inscriptions et médailles (aujourd’hui Académie des inscriptions et belles lettres.)
En 1689, à la demande de Mme de Maintenon, il écrit deux tragédies bibliques pour les demoiselles de Saint-Cyr :
Esther (1689) qui a été écrit avec des chœurs de Moreau. Haendel en tirera l’argument de son premier oratorio (1714). Deux ans après le même Moreau a écrit la musique accompagnant Athalie (1691), ses chœurs étant réécrits par Gossec un siècle plus tard, puis par Boïeldieu en 1813. Comme Esther, cette pièce a inspiré un oratorio à Haendel, Athalia (1733) et Mendelssohn a également composé une musique de scène pour Athalie, et Boris Yoffe un opéra en 2006.
En 1694, il écrit, toujours à la demande de Madame de Maintenon, quatre Cantiques spirituels, dont trois furent mis en musique par Jean-Baptiste Moreau, Michel-Richard de Lalande, Pascal Colasse et Jean-Noël Marchand. Plus tard, c’est Fauré qui écrit son Cantique de Jean RACINE (1865), si agréable à chanter (et à écouter).
Ce cantique a également été mis en musique par Mel Bonis.
Pascal Colasse (1649 – 1709) (qui a également écrit des opéras sur des livrets de La Fontaine et de Rousseau) a mis en musique les Cantiques spirituels.
Jean Racine meurt le 21 avril 1699 à Paris, à l’âge de 59 ans.
(Source : Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, sous la direction de Marcelle BENOIT, éditions FAYARD 1992.)

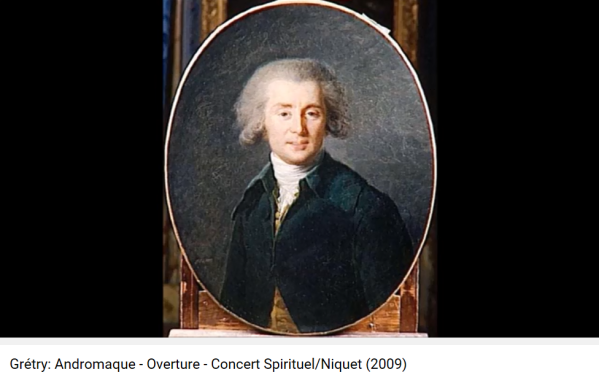



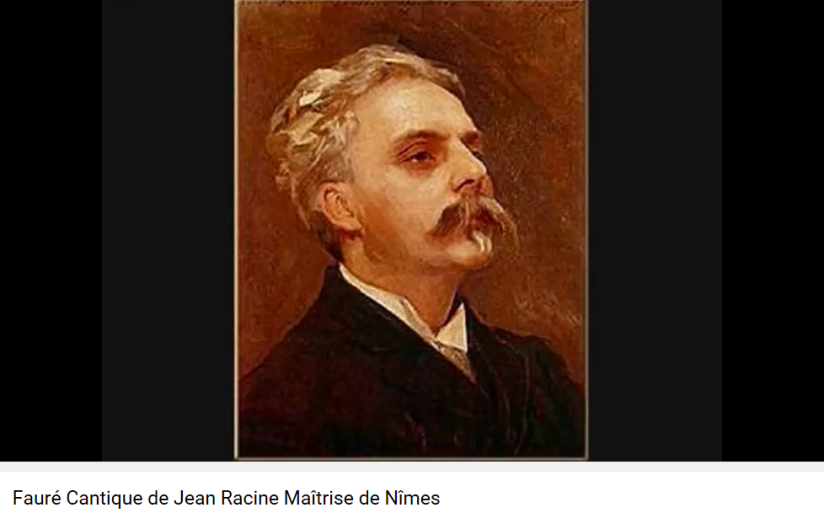


Bonjour Jean-Louis, je ne pensais pas que Racine avait inspiré autant de musiciens, et même bien au-delà du 17é siècle.
Je découvre l’Athalie de Handel grâce à toi, c’est ravissant… quelle voix pure et quelle virtuosité !
Je découvre aussi « Le Cantique de Jean Racine » de Fauré… quelle douceur dans ces mélodies !
Merci d’avoir embelli ma journée ! Bon après-midi !
J’aimeAimé par 1 personne
Oui, tu as raison, Marie-Anne. Et pour moi l’alexandrin racinien est proche de la perfection!
Pour le cantique de Jean Racine de Fauré, pour l’avoir chanté quelque fois, je confirme que quand on l’a en tête, il n’en ressort pas facilement !
Bonne soirée.
J’aimeAimé par 1 personne
Bonjour Jean-Louis. J’ai trouvé cet article très intéressant : il m’a fait découvrir que Racine a inspiré de nombreux musiciens ❣️
J’aimeJ’aime
Mille grazie, Luisa ! 😀
J’aimeAimé par 1 personne
Buona serata ❣️🌼❣️
J’aimeJ’aime